Le bout du temps

Auteur : Denis Turina
Dans la vie courante, le temps s’écoule plus ou moins vite et, comme l’eau
qui sort du robinet, on ne se préoccupe guère de son approvisionnement.
Chacun se projette normalement dans le futur, à court ou à long terme.
« L’année prochaine je déménage. Demain, je pars en voyage. Dans
une heure, je rentre à la maison. Dans deux minutes, j’appelle la tour
de contrôle ».
Quand la situation devient critique, le rythme s’accélère.
Les émotions et les décisions se succèdent rapidement. Les projets,
les décisions et les actes se limitent au très court terme. Il m’est
arrivé de vivre des instants où le terme est tellement court, la possibilité
de se projeter dans l’avenir tellement limitée que, à plusieurs reprises,
j’ai ressenti, j’ai vu, j’ai vécu « le bout du temps ».
Chaque seconde qui s’écoule, porteuse d’un espoir fou, est toute entière
tournée vers la conquête de la suivante. Rien de plus.

C’est le cas en Espagne quand, caché derrière le rideau de mon siège
éjectable, réacteur éteint, sans verrière et dans le bruit du vent,
je continue à compter et je réalise que le siège ne partira plus tout
seul. C’est la prise en compte d’une évidence.
L’altitude est de 7 000 pieds (2.000 mètres). L’avion est contrôlable,
il me reste du temps. Pas de stress, pas de sentiment de réelle urgence,
mais la certitude de travailler en temps limité. L’étude, la mise en
place et l’application d’une solution de remplacement.
 Au départ du siège, le temps est reparti.
Au départ du siège, le temps est reparti.
Mystère IV A n° 311 8-NP (EC
2/8 Nice)
Voir "Et que ça
saute : Première !" Séville (1966)

A Cahors, après avoir relevé les accoudoirs du siège, sans verrière,
fasciné par la vision des arbres qui remplissent tout le « pare-brise »
et par l’arrivée rapide du sol, je ressens, physiquement, la limite
du temps. Elle n’est pas mesurable, mais elle existe, évidente et…très
proche.
« Je vais emboutir la planète. Je suis en train de me tuer ».
« J’ai encore quelque chose à faire ».
« Ne panique pas, réfléchis. Tu as encore au moins deux ou trois
secondes ».
« Les détentes ! Je dois ouvrir mes mains et actionner les
détentes ».
Ouvrir mes mains crispées sur les accoudoirs du siège, m’a demandé
un gros effort de volonté. Dans ma tête, il a fallu que je lâche, que
j’abandonne, ma bouée de sauvetage.
 Au
départ du siège, l’horloge se remet à fonctionner correctement. Au
départ du siège, l’horloge se remet à fonctionner correctement.
F 100 D 42150 (11-EG) EC 1/11 Roussillon
Voir "Et que ça saute : Deuxième
!" Cahors (1967)
En Allemagne,
c’est la négation de l’évidence. Altitude estimée 500 mètres.
Le réacteur ne pousse plus guère, les lampes « Feu » sont
allumées mais, dans ma tête, c’est certainement lié à un problème de
régulation moteur et à une panne dans le circuit électrique.
Une petite voix qui vient de loin me dit : « Tu as le feu,
ça va exploser bientôt ».
Le souvenir du récit des anciens arrive à mon cerveau : « Petit,
si tu as le feu dans la tuyère, tu peux tenir 30 secondes. Si tu as
le feu au moteur, tu as cinq secondes pour faire ta valise et pour partir ».
La petite voix : « Tu as déjà trop attendu. Saute tout de
suite ».
La sensation de me sentir transformé là, maintenant, en chaleur et
en lumière.
La voix de la conscience, ou celle de l’inconscience, qui se fait entendre
et qui dit : « Mais non, il ne faut pas dramatiser, fais ton
boulot. Coupe d’abord le moteur et essaie au moins une fois de rallumer ».
Le sol monte
« On ne rallume pas après un début d’incendie ».
« Mais non, c’est pas un incendie, c’est une panne du circuit
électrique qui perturbe le régulateur. Coupe maintenant, pour avoir
le temps de rallumer en mode de secours ».
A la coupure du moteur, la cabine est envahie par de la fumée.
« Me…., je ne peux plus lire les instruments, je ne vais pas pouvoir
rallumer ».
« Arrête de rêver, c’est trop tard. On ne rallume pas après un
début d’incendie. Tu as le feu et l’avion aurait déjà dû exploser. Saute
tout de suite ».
 Accoudoirs,
détentes, le siège s’en va. Fin du premier acte, l’horloge repart. Accoudoirs,
détentes, le siège s’en va. Fin du premier acte, l’horloge repart.
F 100 D 42122 (11-MV) EC 2/11 Vosges
Voir "Et que ça saute : Troisième !"
Waldkirch (1975)
Le parachute est ouvert, mais déchiré et mal ouvert.
Le siège est emmailloté à l’intérieur. La descente est rapide, trop
rapide. Le sol arrive.
Il n’y a plus de procédure, plus de référence connue, plus rien à faire.
Sans issue.
Il ne reste qu’une petite poignée de secondes avant l’impact de mon
corps sur le sol et je peux les mesurer, toutes, qui s’envolent à la
vitesse de la terre qui monte.
Je veux les vivre, toutes. Les distiller, une à une, toutes.
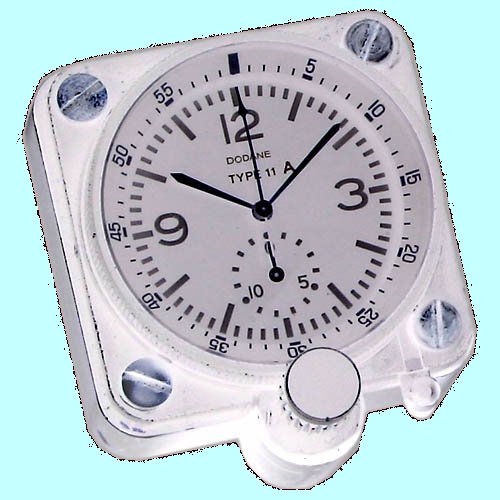 C’est
le bout du temps. C’est
le bout du temps.
Sentiment très désagréable mais ni révolte,
ni sentiment d’injustice. De la résignation.
« Je n’ai pas su, ou pas pu, maîtriser le lion que je pensais
avoir dressé et il va me dévorer. C’est dommage, mais c’est dans l’ordre
des choses ».
« Je vais peut-être rejoindre mes camarades déjà partis et mes
parents ».
Tout à la fin naît une pensée, calme, paisible, évidente, énorme. Une
bouffée, de je ne sais quoi qui monte du plus profond de mes tripes
comme une vague gigantesque qui va me submerger.
«C’est maintenant. J’y suis… Peut-être que je vais bientôt SAVOIR ».
Trois mois de plâtre, six mois d’état-major,
un mois à Aulnat pour découvrir et apprendre les bases du métier de
moniteur, avant de rejoindre l’Ecole de l’air à Salon comme commandant
d’escadron sur Fouga… sans siège éjectable (of course).


Le temps qui n’est pas pris
en compte.
20 juin 1968

En Mirage III-E dans les nuages, je descends de 42.000 pieds (12.500
mètres) avec un réacteur dont le compresseur a décroché. Je n’ai pas
réussi à le refaire fonctionner normalement et je l’ai éteint vers 20.000
pieds (6.000 mètres).
Je suis concentré sur le rallumage sans trop m’occuper du reste car,
contrairement à ce que laisse entendre la sagesse populaire, en phase
de vol « planeur » le Mirage III n’est pas un fer à repasser.
Il se pilote très bien. Seulement, il descend… vite, très vite.
Je gère l’horizon artificiel de secours, l’indicateur de vitesse et
le tachymètre. L’inertie du réacteur en moulinet ne me facilite pas
la tâche. L’altitude diminue rapidement, l’altimètre dévisse.
Enfin, 5 secondes seulement après l’activation du rallumage en vol,
le bruit sympathique du réacteur qui repart me redonne un peu de sérénité.
Le bas de la ressource, tranquille, réacteur pleins gaz, est effectué
vers 4 000 pieds (1.200 mètres), quelque part dans les Vosges, ou légèrement
au-dessus. Je n’ai jamais vu ni l’horizon, ni le sol.
J’étais à l’origine de l’incident. A plus de 40.000 pieds, vitesse
vers 180 kt (350 km/h), réacteur un peu réduit, mais pas suffisamment,
j’ai engagé le combat contre un Mirage III-B du 2/2, l’escadron d’instruction
d’où j’étais sorti trois mois plus tôt.
J’étais plus préoccupé par les manœuvres du biplace que par la bille
et le domaine de vol de mon avion. Le compresseur n’a pas aimé…
Dans ma tête, il fallait absolument que je répare ma
bêtise.
Dans les nuages et faute de voir l’horizon ou des repères au sol,
je n’ai eu aucun sentiment de danger ou d’urgence. Si le réacteur
n’était pas reparti aussi rapidement, je ne serais plus là.
Qu’aurait-on pu penser ? : « Il n’a pas voulu s’éjecter
une troisième fois ? ». Je n’y ai même pas pensé.
Ce jour là la chance était de mon coté, ça arrive aussi.
Auteur : Denis Turina
|